LE TRAVAIL ÉTUDIANT, UN APPRENTISSAGE PORTEUR D’AUTONOMIE
7 août 2025
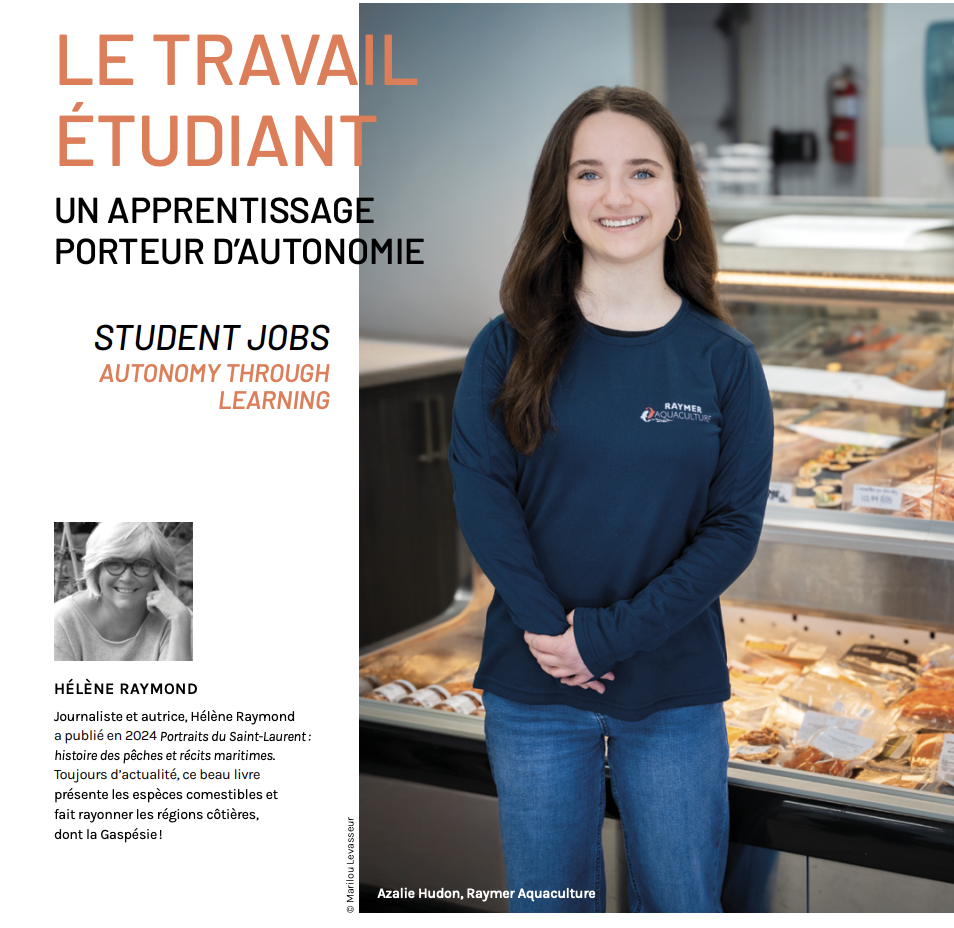
La vie de nos enfants est marquée par des étapes charnières, que l’on pense à leur entrée à la garderie ou à l’école primaire. Parents et grands-parents se rappelleront les émotions qui viennent avec ces moments touchants. Et l’adolescence n’est pas en reste : l’arrivée au secondaire, le premier chagrin d’amour, tout comme cette plongée dans l’univers du travail qui en chavire plusieurs. Que de transformations rapides ! En 2025, Gaspésie Gourmande a choisi de sonder ados et jeunes adultes pour brosser un sympathique portrait de leur place sur le marché de l’emploi au sein d’entreprises bioalimentaires. Vous le constaterez, leur apport contribue à la vitalité régionale.
Vendre à la ferme ; maîtriser les transactions au comptant, par carte de débit ou de crédit ; répondre à la clientèle ; connaître les rouages de l’établissement : les défis sont nombreux, changent en fonction des endroits et les premiers jours sont signe de stress !
Timides au début de notre entretien, mes interlocutrices gagnent en assurance à mesure que le temps s’écoule. Je me dis qu’il s’est sans doute passé la même chose quand elles ont mis les pieds au boulot où, petit à petit, elles ont su se faire une place. C’est vers 14 ans qu’elles commencent à chercher un travail : « Pour avoir quelque chose à faire »; « Parce que j’aime que ça bouge depuis que je suis toute petite »; « Parce que je voulais apprendre. » Quelques années plus tard, elles décrivent avec aplomb les tâches qui leur sont confiées.
Azalie Hudon, employée à la poissonnerie de Raymer Aquaculture à New Richmond depuis l’été 2021, se souvient de ses débuts : « C’était mon premier travail, il fallait tout mémoriser sur les poissons, la rotation de la marchandise dans les comptoirs, m’adresser correctement à la clientèle. C’est fou à quel point on apprend de nouvelles choses ! » Reconnaissante, elle dit qu’on a pris le temps d’expliquer les tâches en détail, avant d’ajouter des notions de cuisine et de fabrication des sushis. Comme pour plusieurs, si le travail occupe les beaux jours, il passe au second rang dès la rentrée scolaire.
Marilou Lepage en est à son troisième été chez Couleur Chocolat, à Sainte-Anne-des-Monts. Quel emploi rêvé pour celle qui se dit fan ! « Ma mère est enseignante, elle reçoit beaucoup de chocolat en cadeau. C’est comme ça que j’ai pu goûter ! » Elle affirme manger tous les types de chocolats, mais ses papilles savent détecter la qualité de ce qu’elle vend. Son premier défi ? Apprendre à servir la crème glacée molle : « Ce sont des étapes précises, répétitives. Mes premiers cornets tombaient, il a fallu de deux à trois semaines pour servir de belles crèmes glacées. Après, c’est super facile ! »
Quant au fait de côtoyer des gens qui ont l’âge de leurs parents et de leurs grands-parents, Azalie et Marilou manifestent un grand respect, de même que de l’affection pour leurs collègues. On comprend que la collaboration, la patience, l’écoute les mettent à l’aise. Marilou dit : « On s’entraide, on divise les tâches, les chocolatiers viennent nous parler. » Azalie complète : « Je ne les aurais pas connus si je n’avais pas travaillé là. Ils ont des connaissances, mais, dans notre équipe, nous aussi pouvons apporter du nouveau. »
UNE MAIN-D’ŒUVRE PRÉCIEUSE
Parmi les provinces canadiennes, le Québec se distinguerait par un taux d’embauche des jeunes plus marqué. Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ), avance les chiffres de Statistique Canada : « En 2023, pour l’ensemble du Québec, pour l’hébergement et la restauration (cette dernière représente à elle seule 75 % des emplois), on comptait 113 200 employé·es de 15 à 24 ans, sur un bassin de 237 700 personnes. Donc 47 % du total. » Même si les chiffres ne sont pas pondérés par région, la Gaspésie ne fait pas exception. Au contraire, le travail chez les jeunes qui fréquentent écoles secondaires et cégeps s’amorcerait plus tôt que dans les plus grands centres urbains.
C’est un peu l’histoire de Billy Bastien, de la Buvette Thérèse, de Percé. Commis de restaurant à 14 ans, il franchit les étapes pour apprivoiser les tâches, un été après l’autre. Puis, il part étudier la comptabilité à Québec, avant de débarquer à Montréal, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et à l’Université du Québec à Montréal, en tourisme et hôtellerie : « J’avais des années d’expérience en commençant mes cours. Je connaissais le jargon, la culture du milieu. » En mars 2020, la pandémie interrompt brutalement sa formation. Il rentre au bercail, retrouve la vie de famille et reprend, dès la fin de l’été, les rênes d’un restaurant. Il a 24 ans : « On a convaincu les prêteurs et réussi, avec mes associé·es, à acheter un établissement quand tous les restos du Québec fermaient. » Billy ajoute avoir bénéficié d’un « cocktail de bonne volonté » pour arriver au but. Grâce aux changements amorcés dans la foulée de la pandémie, c’est à distance qu’il a terminé sa formation.
Aujourd’hui membre du conseil d’administration de l’ARQ, Billy défend les enjeux de la restauration gaspésienne. En s’appuyant sur une offre touristique bientôt centenaire, il a su surmonter les clichés du genre « Ah, les jeunes ! » ou le célèbre « On a déjà essayé, ça ne marchera pas ! » et il a prouvé que la nouveauté, combinée à une part de naïveté, mène loin. Il y voit une façon d’aider ce secteur à s’adapter aux profils des touristes et au prolongement des saisons.
La Buvette ramène dans son giron de 24 à 36 employé·es chaque été. On parcourt des milliers de kilomètres pour revenir travailler et profiter de Percé : « Pour certains, c’est un mode de vie qui oscille entre la restauration hivernale dans l’Ouest et estivale dans l’Est. Nous n’avons jamais été empêchés de faire quoi que ce soit en raison du manque de personnel. »
LE POTAGER DE JUSTINE : JARDINER, APPRENDRE, DONNER
Fière et confiante, Justine Chabot vient au monde « dans les pommes de terre »! Son père, Jean-François Chabot, a assuré la gestion de la production de la Ferme Patasol de Bonaventure, à partir de 2002, avant d’en prendre les rênes, en devenant copropriétaire de l’entreprise avec sa conjointe, Julie Bacon, en août 2023. Comme la plupart des enfants né·es sur une ferme, Justine a eu l’occasion de l’accompagner : « L’automne, on allait voir ce qui se passait, on assistait au déchargement et, avec ma sœur, on triait des pommes de terre et on s’inventait des histoires. Les patates difformes se métamorphosaient en personnages ! » Naturellement, elle y a trouvé un emploi d’été. Jean-François se rappelle : « Au potager, je ne pouvais pas mettre une graine en terre sans qu’elle soit avec moi ! » Alors, depuis 2020, Justine se fait la main au maraîchage, sur une parcelle d’un peu moins de la moitié d’un terrain de football.
D’abord réservées à la famille et au personnel, les récoltes ont grossi au rythme de l’expertise de la jardinière (qui souligne au passage le coup de pouce de son père agronome) et les choses vont si bien que les surplus sont maintenant vendus à l’extérieur : « En 2024, les légumes cultivés en plus grandes quantités ont été des carottes, des rutabagas, des concombres et des tomates. Ensuite : des panais, des choux, des courgettes, des courges musquées, des citrouilles, des poivrons, des piments, des betteraves, des pâtissons et finalement des haricots. En revenus, on a gagné environ 3000 $ et on a remis 750 $ aux Otaries de Bonaventure, le club de natation local. » Vous avez tout saisi : Justine, nageuse d’élite, s’entraîne, compétitionne et surveille la piscine publique ! S’il est prématuré pour elle de définir son orientation de carrière, elle souhaite pousser à fond cet apprentissage estival, et la rumeur dit que ses carottes en botte sont réputées, au point où le jardin devrait occuper plus d’espace dans l’avenir.
UN MODE D’EMPLOI SANS PRÉTENTION
Tout au long de cette joyeuse recherche, j’ai senti de l’affection, beaucoup d’affection, de part et d’autre. Des employeur·ses affirment que ces jeunes sont un prolongement de leur famille ; que leurs réussites, le grand départ pour le cégep ou l’université les réjouissent. Les voir revenir pour travailler ou donner de leurs nouvelles aussi, mais on comprend qu’à un moment, il est temps d’aller voir ailleurs pour enrichir son CV par d’autres expériences de travail.
L’admiration est manifeste : « Dès qu’ils sentent notre confiance, ils deviennent très bons. Ils n’ont pas encore de façons de faire, leur cerveau, en mode apprentissage en raison de l’école, fait qu’ils ne sont pas réfractaires aux commentaires et aux explications », nous dit Véronique Beauchamp, copropriétaire de la Boulangerie artisanale La Pétrie, à Bonaventure. Elle précise du même souffle que la formation prend du temps, mais l’investissement rapporte sur tous les plans. Une idée renforcée par Azalie, Marilou et quelques autres : « Il est important de bien nous former, de prendre du temps et de nous permettre de nous perfectionner », « Ils doivent être là pour nous prêter assistance et savoir comprendre la différence entre le rôle de parent et celui de patron. » Seule mise en garde : « Notre génération ne veut pas faire plus que ce qui est payé. On ne veut pas se laisser exploiter par des patrons qui voudraient profiter de la naïveté des jeunes. »
Azalie, Marilou et quelques autres soutiennent que cet apprentissage de l’autonomie va au-delà de la question financière. Dans un texto bien senti qu’Azalie me transmet après notre entretien, elle précise : « Oui, c’est pour accumuler de l’argent, mais surtout parce que l’ambiance de travail est bonne […], le travail fait partie de ma routine et me permet de me changer les idées, de voir d’autres personnes comme mes collègues et les clients, ça me permet de bouger encore plus, car c’est un travail quand même physique, on a toujours quelque chose à faire et ça fait du bien d’aller travailler. »
DE CHOUETTES AMBASSADRICES !
À la question « Qu’offrirais-tu à une personne que tu visites en dehors de ta région et qui représente pour toi le meilleur de la Gaspésie ? », spontanément, Marilou choisit le chocolat : « En particulier la gamme de chocolats forestiers de Couleur Chocolat, très originaux et vraiment distinctifs. » Elle les adore ! Pour sa part, Azalie se ferait porte-parole des richesses aquacoles et maritimes, en offrant de l’omble chevalier fumé chez Raymer ou des crustacés, en saison : « Parce qu’ils font partie de l’identité gaspésienne. » Quant à Justine, elle emplirait un panier de ses légumes frais ou irait à la Ferme Bourdages (Saint-Siméon-de-Bonaventure) afin de choisir un cadeau sucré ou alcoolisé.
Au fil de vos vacances, en saisissant votre cornet de crème glacée, votre sac d’épicerie, votre pain tout chaud ou votre bière locale, dites-vous que votre voyage ne serait pas le même sans la vitalité et la fraîcheur qui caractérisent cette jeune main-d’œuvre et qu’à un moment charnière de la vie, ils et elles sont aussi les porte-étendards de cette Gaspésie que nous aimons tant!
_______________________
Un article d'HÉLÈNE RAYMOND
Journaliste et autrice, Hélène Raymond a publié en 2024 Portraits du Saint-Laurent : histoire des pêches et récits maritimes. Toujours d’actualité, ce beau livre présente les espèces comestibles et fait rayonner les régions côtières, dont la Gaspésie !